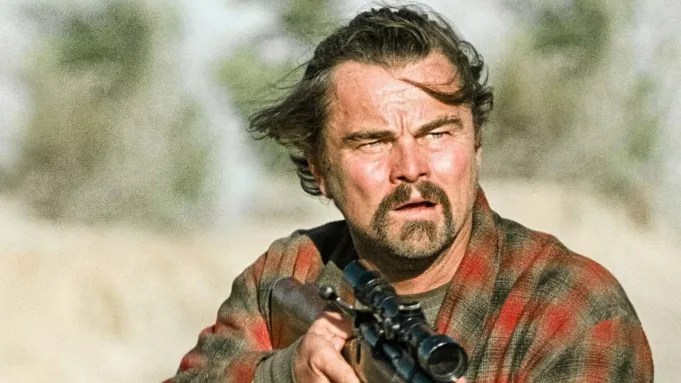On retrouve dans Father, Mother Sister Brother (2025), le cinéma cotonneux, minimaliste et comme suspendu de Jim Jarmusch. Mais c’est pour mieux cacher une cruelle morale : c’est lorsque les parents ont disparu qu’on finit par les comprendre et les aimer.
Trois récits, ou trois nouvelles, occupent la matière du film. La première, qui se déroule dans le New Jersey, raconte la visite de deux enfants à leur vieux père, retiré dans une maison au bord d’un lac. Le fils aide son père financièrement, la fille est plus distante ; tous deux portent sur leur père un regard consterné. Un sentiment de gêne, que Jarmusch communique au spectateur, une impression de relations factices, sourd de toute leur conversation. Quand les enfants repartent, soulagés que ce supplice ait pris fin, le père remet en ordre son salon, qu’il avait dérangé à dessein. Car les enfants ne connaissent pas cet homme qu’ils appellent papa, qui vit beaucoup mieux qu’ils ne le croient. Cet épicurien leur dissimule sa Rolex, sa BMW, ses virées nocturnes en bonne companie, sa vie véritable. Entre le père et les enfants, tout est rituel et rôle appris, decorum artificieux, rien n’est vrai. Tom Waits joue le père indigne et malicieux, Adam Driver et Mayim Bialik, les enfants bernés.
Le deuxième récit, qui se passe à Dublin, réserve aux enfants un sort encore plus cruel : la mère ne prend même pas le soin de se cacher, de dissimuler le peu d’estime qu’elle porte à ses deux filles. Lorsqu’elle les reçoit à Dublin, pour leur thé annuel, elle les écrase de sa superbe, de sa silhouette austère, de la raideur des rites familiaux qu’elle impose. La table débordant de gateaux, le bouquet de fleurs trop grand, fait voir la frontière infranchissable qui sépare la mère et les filles. La gêne ressentie lors de la première histoire est encore plus grande, car ici toute ironie a disparu. Charlotte Rampling joue la maitresse mère, Vicky Krieps et Cate Blanchette, les filles dominées. La cadette (Krieps) a pris le parti de tout dissimuler à sa mère sur sa propre vie (parti le plus heureux, la mère s’intéresse un peu à elle), l’autre (Blanchett), aux lunettes ingrates qui dévorent son visage, essaie péniblement de se conformer aux injections maternelles (mais c’est la plus malheureuse, car elle attend de sa mère une chaleur qui ne vient pas, et la moins aimée).
Ces deux histoires sont comme des nouvelles amères où règne le saracasme et c’est peut-être en tant que nouvelles, plutôt qu’en tant que films, qu’elles auraient trouvé la forme artistique la plus à même d’exprimer les sentiments qu’elles contiennent, ce mélange de jugement, de ressentiment et de cruauté, que certains nouvellistes ont su restituer à force de retenue.
Puis vient le troisième récit, qui se déroule à Paris, et qui est entièrement dépourvu de la méchanceté des premiers segments. C’est que les parents, qui ont quitté les rives anglo-saxonnes pour s’établir en France, sont morts. Restent les enfants, un frère et une soeur, qui peuvent enfin vivre libres en faisant assaut de tendresse. Ils sont enfin maitres des rites et des cérémonies, libres de trinquer comme ils l’entendent. La mélancolie, les souvenirs, les photographies des parents, les aident à vivre et à se souvenir. L’appartement des parents est ici vide. Toute le decorum a disparu, tous les objets, tous les meubles qui encombraient les premiers récits, de leur masse envahissante, ont été mis au rebut, comme si Jarmusch voulait dire qu’il fallait se débarrasser du decorum pour renouer des liens de tendresses, ce qui ne parait pas tout à fait juste, car tout objet familier se leste d’une présence, retient dans sa forme l’ombre d’un souvenir, et donne un cadre au monde et aux relations familiales. Du reste, on peut difficilement vivre dans un appartement vide. Paradoxalement, ce troisième segment aux sentiments doux, indispensable à la compréhension du film, paraît parfois cinématographiquement moins accompli, ou moins acéré, que les deux premiers.
Entre ces tranches de vie, des rimes visuelles et verbales se font échos, expression de la manière décalée du réalisateur : des ados en skateboard filmés au ralenti, symboles de liberté, des couleurs récurrentes, une référence à une vieille expression anglaise (Bob’s my uncle) soulignant l’espace temporel et affectif existant entre parents et enfants dans les deux premiers récits. Et d’autres choses encore.
Malgré le savoir-faire indéniable de Jarmusch qui sème d’indices ces récits, et la douceur des images qui nimbe et atténue la cruauté du trait, on peut regretter la morale un peu univoque de l’ensemble (toute relation familiale verticale entre parents et enfants apparait faussée, les relations heureuses ne sont possibles qu’entre frères et soeurs à condition que les parents disparaissent), et l’horizon volontairement borné de ces récits familiaux. Reste le premier sketch, le plus réussi.
Strum